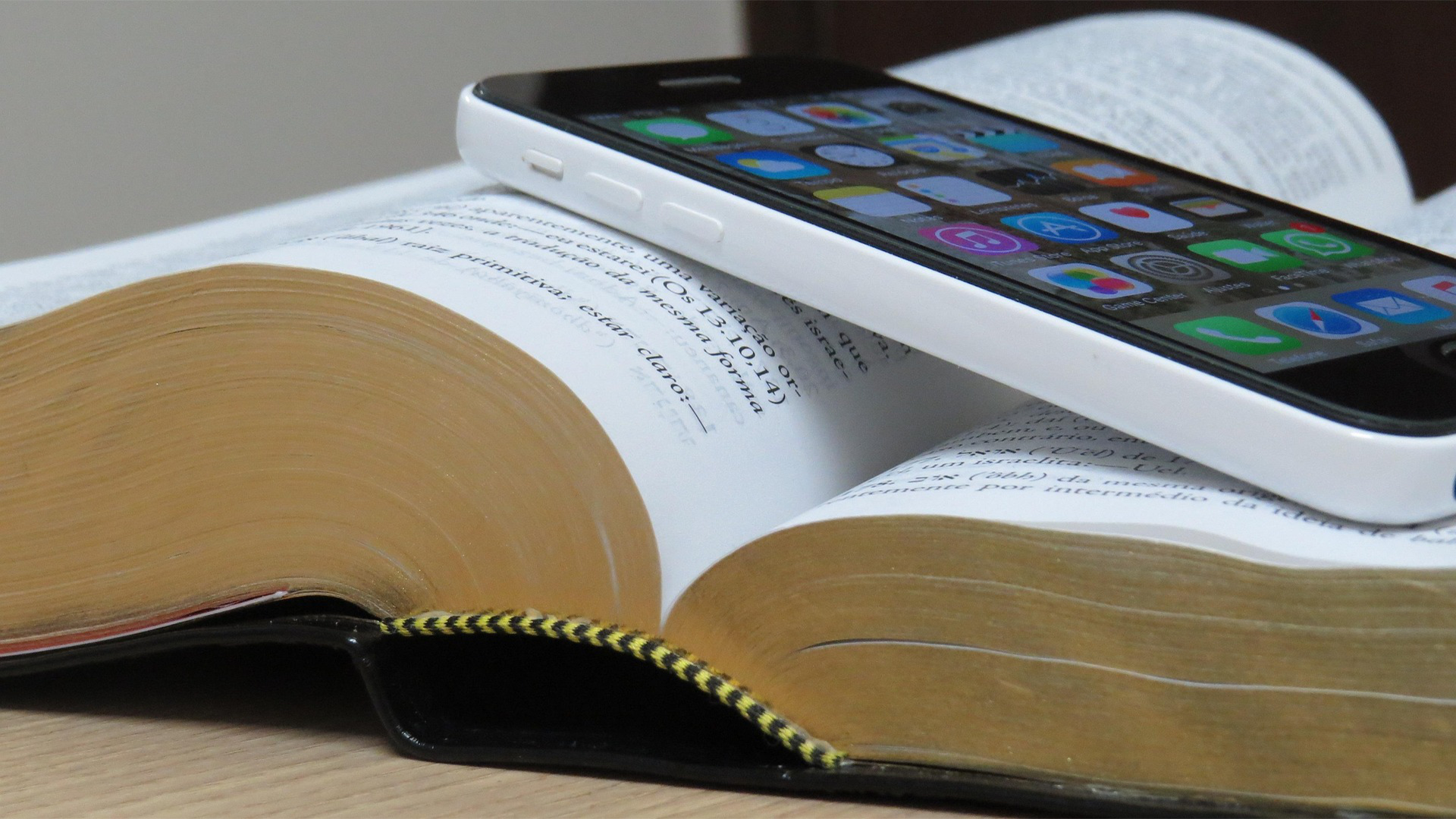Depuis 2’000 ans, l’engagement dans la foi chrétienne a été marqué par le signe du baptême. Ce signe marque le renoncement aux mauvaises actions, le choix de suivre les enseignements de Jésus-Christ et la confiance placée en lui. Dès le temps de Jésus, des croyants ont été baptisés dans des points et cours d’eau naturels. Cette pratique a aussi eu lieu, de longue date, dans le Léman, sans susciter d’esclandre. Mais la possibilité en a récemment été déniée à deux Eglises évangéliques.
Dans leur grande majorité, les Eglises évangéliques baptisent exclusivement des personnes en âge de raison, considérant que l’engagement chrétien ne peut résulter que d’un choix personnel et responsable. Baptiser des adultes est une pratique de toutes les Eglises, la singularité évangélique est de ne pas baptiser de nourrissons.
Pourquoi donc l’interdiction de baptiser au lac ? Et pourquoi est-elle problématique ? La Loi sur la Laïcité de l’Etat avait exclu en principe les manifestations cultuelles sur le domaine public, dont le lac et les cours d’eau font partie, mais avait été dans un premier temps appliquée avec souplesse et grandes déclarations d’ouverture, en accordant les autorisations demandées. Est entré en vigueur récemment un règlement d’application, qui restreint la possibilité de demander autorisation pour une manifestation cultuelle aux seules communautés religieuses qui ont demandé à établir une relation avec l’Etat et signé des engagements spécifiques. En conséquence, toutes les autres communautés religieuses se verront refuser toute autorisation sans autre examen. Or le Tribunal fédéral reconnaît que la tenue de manifestations cultuelles dans le domaine public ressort de la liberté religieuse garantie par la Constitution, et qu’une interdiction de principe est disproportionnée. Il est alors choquant qu’un règlement de l’Etat mette des conditions au fait d’évaluer l’application d’un droit fondamental.
Nous voilà donc dans le cas regrettable, et malheureusement pas nouveau, où la Cité des droits de l’homme empiète sur ces derniers. En cause, une compréhension fautive de la laïcité, qui voudrait cantonner tout vécu religieux dans la sphère privée. La laïcité signifie que l’Etat doit être neutre religieusement. Mais le domaine public est à tous. L’Etat en administre l’usage en accord avec les droits et libertés de chacun, mais il n’est pas engagé par ce qu’il autorise dans le domaine public.
D’autre part, il est demandé aux religieux la maturité d’accepter le blasphème, que leurs croyances soient ridiculisées publiquement. Ne serait-il pas juste d’attendre des incroyants la maturité de supporter que les croyances des autres soient exprimées et visible, même si cela devait déranger ?
Finalement, voulons-nous des libertés fondamentales qui ne s’appliquent qu’à ceux qui ont les « bonnes » (in-)croyances, ou bien un Etat réellement neutre et impartial entre croyants divers et incroyants en tous genres ?
Jean-René Moret, pasteur dans l’Eglise évangélique (FREE) de Cologny
(Cette opinion est parue dans le Courrier des lecteurs de La Tribune de Genève samedi 20 août : www.tdg.ch/la-laicite-et-les-baptemes-au-lac-386811690171).