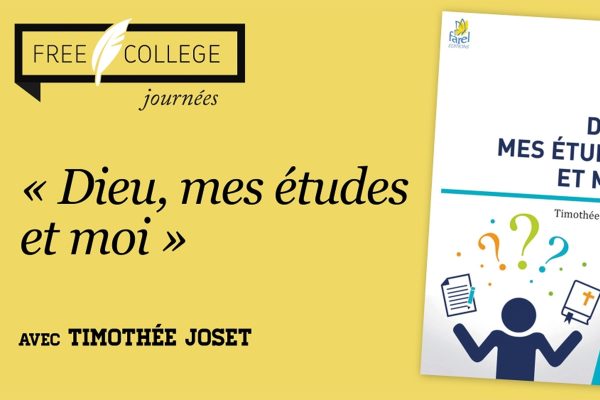La Genève internationale et humanitaire se bat pour sa survie, sous les coups combinés des coupes budgétaires et de la cherté de la vie à Genève. Les institutions internationales sont à la fois un poumon économique de la cité, une contribution au monde, et un élément identitaire. Il n’est pas vain dans ces circonstances de se demander comment la cité de Calvin a acquis ce rôle international auquel rien ne la prédestinait. La neutralité suisse entérinée au congrès de Vienne était certainement un facteur important. Son passé de « Rome protestante » et de lieu de passage des réfugiés huguenots qui se sont dispersés dans le monde après la révocation de l’Édit de Nantes a aussi pu lui donner un premier rayonnement international.
Touché par le sort des blessés de guerre
Mais l’élément décisif sera la fondation à Genève de la Croix-Rouge et la conclusion des conventions de Genève au milieu du XIXe siècle. La ville devient alors le lieu logique pour implanter de nouvelles institutions internationales, en profitant des synergies avec celles qui s’y trouvent déjà, et de son aura de ville de paix et de négociation.
Aux origines de ces évènements se trouve Henri Dunant, un aventurier genevois marqué par le renouveau religieux qui anime Genève dès les années 1810 (dit «Réveil de Genève»). Présent aux abords de la bataille de Solférino (1859), il publie en 1862 Un souvenir de Solferino en évoquant le sort tragique des blessés de guerre abandonnés ou recevant des soins insuffisants. Il propose la fondation d’un organe neutre de secours au blessé, et l’établissement d’une convention protégeant les blessés et ceux qui les soignent. Les deux propositions seront concrétisées par la première Convention de Genève et la fondation de la Croix-Rouge, avec un comité initial formé de personnalités protestantes genevoises.
L’amour des ennemis
Gustave Moyner, premier président de la Croix-Rouge, donne dans ses mémoires un regard explicite sur la motivation de la Croix-Rouge : «C’est la morale de l’Évangile qui, à mesure qu’elle a pénétré plus profondément les peuples, les a façonnés davantage au sacrifice. C’est elle qui, après avoir inspiré aux hommes une pitié active pour leurs semblables dans l’angoisse, a fini, après bien des siècles de résistance, par obtenir d’eux qu’ils pratiquent en masse ce qui est le comble de la vertu : l’amour de leurs ennemis».
Bien sûr, les principes qui ont inspiré la Croix-Rouge ont été formulés sans référence religieuse explicite, et ont été adoptés par des personnes et pays de toutes convictions. Et les acteurs du social et l’humanitaire peuvent avoir toutes sortes de regard sur la foi et de relation avec les croyants. Elles sont cependant meilleures lorsque le monde humanitaire se rend compte combien ses valeurs ont été inspirées de la foi chrétienne, et lorsque les chrétiens conservent l’esprit des pionniers qui alliaient foi vivante, engagement au service du bien commun, et disposition à collaborer avec toutes les personnes de bonne volonté. Puissent ces valeurs de service du prochain et d’amour de l’ennemi avoir encore de beaux jours !
Groupes bibliques des écoles et universités https://www.gbeu.ch/